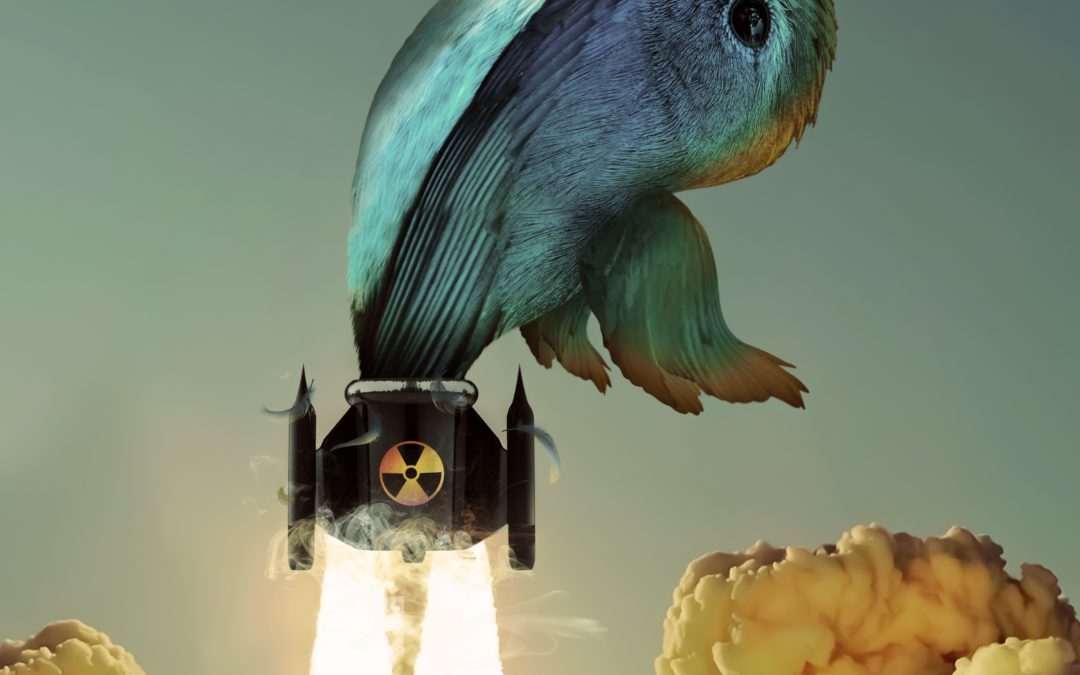En temps de guerre, quand la violence devient quotidienne et que les images de destruction affluent sans répit, un phénomène insidieux s’installe : l’engourdissement psychique. Ce mécanisme de survie permet de tenir face à l’horreur, mais il a un coût énorme : il coupe les individus de leurs émotions, rendant supportable l’insupportable. Ce phénomène touche autant les victimes que les auteurs de crimes. Les premiers finissent par ne plus réagir à la souffrance tandis que les seconds parviennent à justifier leurs actes en refoulant toute culpabilité.
Selon une étude norvégienne, la Terre a connu en 2024 le nombre de conflits armés le plus élevé depuis 1946, détrônant 2023 qui était déjà une année record. En effet, pas moins de 61 conflits ont été enregistrés dans le monde, répartis entre 36 pays. Siri Aas Rustad, autrice principale du rapport couvrant la période 1946-2024, souligne qu’il ne s’agit pas d’un simple pic conjoncturel mais d’un véritable tournant structurel : le monde est aujourd’hui bien plus violent et fragmenté qu’il ne l’était il y a dix ans. Ces données viennent confirmer le ressenti général d’une tendance va-t-en-guerre d’une partie des dirigeants de ce monde. L’écriture inclusive semble ici inutile tant ce terme se conjugue au masculin.
Et pourtant, en ce mois d’août, nous commémorions les 80 ans du bombardement atomique. L’info est presque passée inaperçue tant les récits de guerres sont quotidiens sur toutes les chaînes. Le piétinement du droit international par Israël et la complicité du monde occidental marque également un tournant. Toutes les chartes et la volonté presque consensuelle d’une paix durable après la Seconde guerre mondiale sont en train de voler en éclat. Plus rien ne fait sens. Il suffit d’un droit de véto à l’ONU pour freiner les tentatives de faire cesser un génocide. Les intérêts financiers et les alliances stratégiques priment sur la vie humaine. Et si, au fond, nous avions simplement été naïfs, croyant que le monde suivait un ordre moral ?
Il est bon ton de rappeler que le fer de lance du « monde libre » a méprisé la primauté du droit : de l’invasion illégale de l’Irak à la fabrication de faux renseignements sur les armes de destruction massive, en passant par la torture systématique, les enlèvements organisés et les détentions sans limite. Entre 1976 et 2009, les Etats-Unis ont mené plus de 400 interventions militaires en dehors de leur territoire. Une étude de l’organisation Reprieve datant de 2014 révélait que les actions des USA dans le but d’éliminer 41 cibles par des frappes de drones au Yemen et au Pakistan, avaient provoqué la mort de 1147 personnes, soit 28 innocent·es tués pour chaque suspect, y compris des femmes et des enfants.
Ces atrocités ont été totalement intégrées à nos vies. Nous nous sommes accoutumés à la mort de civils, présentée comme nécessaire par le récit du soft power américain pour défendre le « monde libre. Et tant pis pour les pertes humaines, la lutte contre le terrorisme a fait en réalité bien plus de victimes civiles que le terrorisme lui-même. De ce narratif occidental en résulte une faillite totale de sa morale. Derrière les beaux discours de paix et les condamnations des dictatures se cachent une hypocrisie de plus en plus insupportable. Le génocide à Gaza et l’incapacité des puissances mondiales à agir nous le démontrent un peu plus chaque jour.
Et aujourd’hui, à force d’être saturée d’images parfois décontextualisées dans les médias, une partie de la population subit cet épuisement empathique, entraînant une indifférence collective. Cette forme d’engourdissement psychique des images de guerre mêlée à une impuissance totale face à des crimes abjects nous pousse à vouloir abandonner pour ne pas sombrer psychologiquement. Si la santé mentale est un sujet à ne pas négliger et à prendre avec le plus grand sérieux, la lutte pour les droits fondamentaux des humains l’est tout autant. N’oublions pas ces gens qui risquent chaque jour leur vie juste pour manger et boire. N’oublions pas non plus ceux qui sont complices de ces massacres. Même dans notre « belle Suisse », ils sont nombreux à avoir trahi leur âme au profit du plus fort, du plus riche et du plus compatible économiquement.
Yoann Bodrito, rédacteur en chef